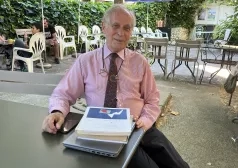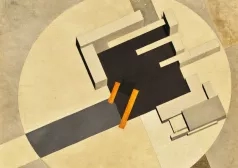Русский акцент | Блог Надежды Сикорской | Новая публикация
"Два прокурора"

L’accent russe | Le blog de Nadia Sikorsky | Nouvel article
"Deux procureurs"

Russian Accent | Blog of Nadia Sikorsky | New publication
"Two prosecutors"