L’Internat, roman de l’écrivain ukrainien Serhiy Jadan (éd. Noir sur Blanc, traduit de l’ukrainien par Iryna Dmytrychyn), est disponible dès aujourd’hui dans les librairies suisses et françaises. J’aime présenter les livres des écrivains contemporains sous la forme d’interview avec l’auteur, ce qui permet non seulement de comparer mon impression de lectrice avec la position de l’écrivain, mais aussi de mieux révéler sa personnalité. J’avais l’intention de faire la même chose avec le roman de Serhiy Jadan, qu’en 2014 j’appelais encore Sergueï, d’autant plus que j’avais déjà écrit plusieurs articles sur cet auteur. Malheureusement, cela n’a pas été possible : Serhiy a refusé de faire une interview en russe. Ma première réaction a été l’indignation : comment était-ce possible ?! Puis j’en ai été attristée, car une interview est avant tout un dialogue, et chaque interview non réalisée est une occasion manquée de s’écouter mutuellement, et peut-être de trouver des points de convergence. Finalement, je me suis demandée si j’avais le droit de juger Serhiy depuis mon bureau genevois, quand lui était à Kharkiv, écrivant, s’exprimant publiquement, organisant un festival littéraire, récoltant de l’argent pour fournir des prothèses à ses concitoyens mutilés ? Non, bien sûr. Et de manière générale, on ne doit juger un écrivain qu’à ses livres, or L’Internat est un livre à part, que tout le monde devrait lire.
Au risque de déplaire à Serhiy Jadan, je dirais que son roman est écrit, de mon point de vue, dans la meilleure tradition de la littérature russophone humaniste, telle que l’a fondée Nikolaï Gogol : une grande tragédie est montrée par les yeux d’un « petit homme », exerçant la profession la plus paisible au monde – Pacha, un prof de 35 ans. Il enseigne l’ukrainien, langue dans laquelle il ne parle que pendant les cours à l’école, alors que dans la vie il s’exprime dans sa langue maternelle, le russe. Ce « petit homme » paraît faible et sans défense, mais à mesure que l’histoire se déroule, il acquiert des traits héroïques. Tout comme, en son temps, Alexandre Soljenitsyne avait tenté de faire tenir dans Une journée d’Ivan Denissovitch toute la masse du système des camps soviétiques – vous avez bien sûr compris l’allusion à ce texte historique dans mon titre –, Serhyi Jadan raconte l’horreur inexprimable d’une guerre fratricide à travers trois journées de la vie de son personnage. Il la raconte d’une telle façon que vous dévorez les 260 pages du livre dans un état de tension terrible, presque physique, serrant les dents et écarquillant les yeux.

Dans mes publications des derniers mois, je me suis demandée plus d’une fois si les réalités d’aujourd’hui allaient faire éclore de grandes œuvres littéraires. Je pense que L’Internat est la première, même si elle ne traite que du « prélude » de ces réalités. Le livre se déroule en 2015, dans le Donbass, et l’auteur connaît bien les événements décrits, car il vient de là-bas, de Starobielsk dans la région de Louhansk, qui, après le début du conflit militaire à l’est de l’Ukraine au printemps 2014, s’est retrouvé sur la ligne de front. (Et comment ne pas penser ici aux Souvenirs de Starobielsk de Joseph Czapski – impossible d’échapper aux associations d’idées littéraires !) La guerre, qui n’a pas encore débordé des frontières de l’État, a déjà formé des frontières intérieures, et l’une d’elles s’étend tout près de la modeste maison de Pacha, près de la gare ferroviaire, ne cessant de s’imposer dans sa vie sans rien de remarquable : il a un travail qu’il n’aime pas beaucoup, un salaire misérable, un statut d’invalide, une sœur désordonnée, une vie privée ratée, un père âgé et à moitié sourd, pour lequel, comme pour beaucoup de gens de sa génération, « la télévision est devenue la flamme éternelle ». C’est avec les mots du père, ou plutôt, son hurlement, « Va le chercher ! », que commence le roman. Qui doit-il aller chercher ? Sacha, le neveu de Pacha, que sa maman (la sœur de Pacha) a confié à un internat, où notre instituteur va se rendre. Le voyage aller-retour jusqu’à l’internat, qui est situé dans leur ville, à un jet de pierre, se fera en ces fameuses trois journées qui concentrent toute la nouvelle vie des habitants. Elle a radicalement changé pour Pacha, en un temps record : « Un an et demi a passé. Plus personne n’a besoin de cours du soir. Les enfants se sont dispersés. Maryna l’a quitté. Le prof de travaux manuels s’est retrouvé de l’autre côté de la ligne de front. » D’abord avec Pacha, puis avec Pacha et Sacha, le lecteur avance tant bien que mal dans l’obscurité et le brouillard, à travers la ville détruite, mutilée, heurtant des débris de machines, des affaires abandonnées, des cadavres…
Avec eux, il se réfugie dans un sous-sol glacé, échappe à une meute de chiens errants, se cache des militaires, observe l’internat dévalisé par les pillards, se fige devant l’avancée d’un tank T-64, se fond dans la foule perdue, en colère, transie de froid, épuisée, une foule qui parle dans un mélange d’ukrainien et de russe, ne comprenant plus où sont « les nôtres » et « les vôtres », et n’essayant même plus de comprendre – voir La Garde blanche de Mikhaïl Boulgakov ! –, ne désirant qu’une chose : atteindre un abri chauffé. « Le froid enlève la sensibilité des mains et du visage, on n’a qu’une envie, se retrouver le plus vite possible dans un intérieur chaud. Peu importe qu’il soit sans lumière et sans eau, l’essentiel est qu’il ne soit pas froid, l’essentiel est de se réchauffer. » Comment, en lisant ces lignes, ne pas penser à l’hiver qui approche ? En compagnie des personnages principaux, le lecteur « discute » avec les femmes et les enfants, les chefs de gare qui se succèdent, les militaires des deux camps, avec un correspondant étranger qui considère leur tragédie comme un simple spectacle.
Et nous ne nous étonnons déjà plus que dans les moments les plus critiques, ce soit justement chez Pacha, le « petit homme », que se réveillent des qualités de leader : c’est lui, seul gentleman du groupe, qui aide les femmes et les vieillards à avancer dans la ville nocturne ; lui qui, se présentant comme le « délégué de la communauté», obtient qu’on nourrisse la foule affamée à la gare ; puis il tombe sur un chirurgien d’un hôpital de campagne, argumente avec sa propre mort, maintient un combattant qu’on opère sans narcose, un garçon d’à peine vingt ans. En regardant Pacha, les autres commencent à se souvenir qu’ils sont aussi des êtres humains. Mais que ressent-il lui-même, le « petit homme », pendant ces instants ? « Son cœur se serre, il sent sa tête tourner, titube. Il tente de reprendre ses esprits. Il a l’impression d’avoir à l’intérieur de lui depuis deux jours un ressort en acier qui se tend, grand et froid. Il se tend constamment, chaque minute, chaque seconde. Il se tend jusqu’au bout, jusqu’à la limite. Il se tend, presse contre la poitrine, empêchant de respirer, coupant l’air. » Voilà ce qu’il ressent, après avoir vaincu sa peur viscérale.
La guerre est le thème principal, omniprésent, du roman L’Internat. Mais parallèlement à la guerre, nous voyons se développer le thème d’une irresponsabilité générale et d’une responsabilité tout aussi générale : quand personne n’est coupable, tout le monde l’est. Le rôle, traditionnel dans la littérature russe, du jurodiviy, ou du fol-en-Christ accusateur, l’innocent qui révèle que le roi est nu, est tenu par la directrice de l’internat, Nina, qui y a grandi. C’est de ses lèvres que sort la sentence sévère, adressée au lecteur : « Mais vous vous êtes habitué à vous cacher toute votre vie. Vous avez pris l’habitude de considérer que vous n’y êtes pour rien, qu’il y a toujours quelqu’un qui réglera les choses pour vous, que quelqu’un décidera de tout. Non, personne ne réglera, personne ne décidera. Pas cette fois. Parce que vous avez tout vu et que vous saviez tout. Mais vous vous êtes tu, vous n’avez rien dit. On ne va pas vous juger pour cela, évidemment, mais ne comptez pas sur la mémoire reconnaissante des descendants. » Un autre thème essentiel du roman, ce sont les enfants. Nous vivons avec Pacha ses tourments moraux pour ne pas être intervenu quand on a envoyé Sacha à l’internat, et ne pas l’avoir repris plus tôt. Nous comprenons combien il est important pour chaque enfant de savoir qu’on l’aime, qu’on le comprend et qu’on le défend, qu’on ne le trahira ni ne l’abandonnera jamais – or, nous restons tous des enfants tant que nos parents sont vivants. Nous comprenons l’effet destructeur de la guerre sur les enfants qui « ne sont pas nés au bon moment » et sont obligés de mûrir prématurément. Les dernières pages du roman sont écrites du point de vue de Sacha, un merveilleux garçon, sage, fort, aimant, attentif. Adulte. Au grand soulagement du lecteur, tout se termine bien pour Pacha et Sacha : ils rentrent à la maison. Une maison qui sent « les draps propres ». L’odeur de la paix. Mais, je le rappelle, ce n’est que le prélude.



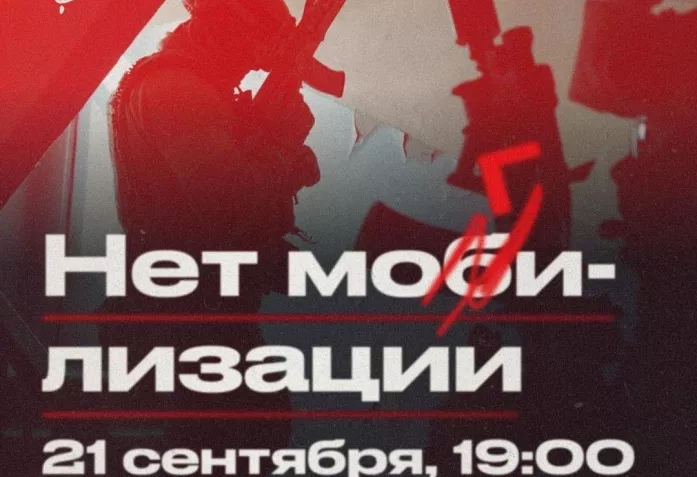


















COMMENTAIRES RÉCENTS