Un volume de 576 pages intitulé Tomas Venclova: Nord magnétique. Conversations avec Ellen Hinsey vient de paraître aux Éditions Noir sur Blanc, à Lausanne, traduit de l’anglais par Eva Antonnikov. Sur le fond, c’est la vie de Tomas Venclova racontée par lui-même : la vie d’un poète, philosophe, traducteur, défenseur des droits humains, né en 1937 à Klaipeda, en Lituanie. Celui dont le destin reflète tout le XXe siècle fit ses études dans les universités de Vilnius et de Tartu et séjourna souvent à Moscou et à Leningrad. Ses poèmes furent traduits pour la première fois en russe par son ami Joseph Brodsky – qui lui dédia, en 1971, son cycle Divertissement lituanien. Venclova, quant à lui, a traduit en lituanien non seulement Brodsky, mais aussi Pasternak, Mandelstam et Akhmatova. En décembre 1976, il fut l’un des fondateurs du Groupe Helsinki lituanien, et en 1977, il quitta l’Union soviétique pour les États-Unis, sur invitation de l’université de Berkeley. À partir de 1980, il enseigna à l’université de Yale dont il demeure professeur honoraire.
Sur la forme, c’est une série d’entretiens avec la poétesse américaine Ellen Hinsey, qui a notamment traduit plusieurs poèmes de Venclova en anglais ; à l’instar d’Ariane, dans la mythologie grecque, elle guide son interlocuteur épistolaire – ainsi que les lecteurs et lectrices – à travers les bouleversements du siècle dernier.
L’idée du livre est née en été 2003 en Suisse, au Château de Lavigny où les deux poètes se trouvaient alors en résidence. Quinze ans plus tard, j’ai eu le privilège de faire la connaissance de Tomas Venclova à Lavigny. À l’occasion de la parution de ce nouveau livre, je vous propose l’interview réalisée avec le poète en 2018, qui n’a rien perdu de son actualité.
Tomas Vencova, dans quelle langue rêvez-vous ?
Généralement, dans ma langue maternelle, en lituanien.
En trente ans passés aux États-Unis, ne vous êtes-vous donc pas américanisé ?
Absolument pas. En général, je n’aime pas trop l’Amérique, pour deux raisons. Premièrement, il n’y a pas là-bas de vraie architecture européenne : le gothique, le baroque ; et le classicisme est faux. Il y a des gratte-ciels, de riches villas, mais c’est autre chose. Deuxièmement, il est impossible de s'y déplacer à pied. Il est vrai que ma femme et moi habitons dans une commune où c’est justement possible, nous n’avons même pas de voiture, ce qui est perçu comme une forme particulière de snobisme. Nous n’avons pas de maison non plus, et vivons dans un appartement. Faire des travaux dans sa maison ou s’affairer dans un potager, cela ne m’intéresse pas. En revanche, j’aime beaucoup voyager, et je peux me le permettre même maintenant, à la retraite.
Chez vous, on est poète de père en fils. Votre père écrivait des poèmes, mais il occupait également des postes de responsabilité, il faisait partie du système soviétique. Qu’est-ce qui vous a poussé vers la dissidence ?
J’observais, tout simplement, ce qui se passait dans mon pays, je réfléchissais et j’ai assez vite compris qu’il y avait une faille dans ce système, qu’il fallait le changer. Plus tard, j’ai compris que les changements n’aideraient pas : le système ne pouvait que s’effondrer, et pour cela, il fallait, comme l’a dit Soljenitsyne, « ne pas vivre dans le mensonge ». Ce qui veut dire qu’on ne pouvait soutenir ce système ni par la parole ni par l’action, mais qu’au contraire, il fallait le secouer. Dans ma profession, les secousses provenaient des traductions en lituanien de la littérature occidentale moderne : Eliot, Joyce, Rilke, Borges et plusieurs autres. Les traductions de Shakespeare, de Dickens, de Goethe permettent de ne pas vivre dans le mensonge, et beaucoup de gens vivaient ainsi.
Comment avez-vous appris que vous aviez été déchu de la nationalité soviétique ? Quelle a été votre première réaction ?
Ma première réaction, ce fut du soulagement. Je m’y attendais et j’étais même étonné que l’on ne m’ait pas déchu plus tôt. Car, en partant enseigner à Berkeley avec un passeport « rouge », je me comportais avec une insolence inhabituelle pour un Soviétique.
Comment vous a-t-on laissé partir ?
Le pouvoir avait un dilemme : soit m’incarcérer pour quinze ans, soit me laisser partir. J’étais comme le fils de Gorki, Maxime Pechkov, et un écrivain de surcroît. Mais j’ai eu plus de chance que Pechkov – on m’a laissé partir, alors que mon père était déjà décédé et ne pouvait plus rien pour moi. Et je me retrouve à changer 500 roubles contre 600 dollars américains, selon le cours officiel (au noir, c’était 10 roubles pour 1 dollar, le rouble était officiellement un peu plus cher que le dollar). Je suis allé d’abord à Paris où j’ai vite dépensé l’intégralité de cette somme – il y avait trop de séductions ! Lorsque j’ai eu besoin d’argent, je suis allé voir Alexandre Galitch à Radio Liberty, et j’ai donné une interview plutôt innocente sur les traductions de Mandelstam en lituanien. Avec les 100 dollars que j’ai gagnés, j’ai pu subsister encore quelques jours. À mon arrivée en Amérique, je suis intervenu dans un comité du Congrès pour exposer la situation des droits humains en Lituanie. En gros, j’ai affirmé que la situation aurait pu être meilleure, mais sans outrance. Or, le fait même de mon intervention était un délit ! À Berkeley, j’ai enseigné de janvier à août 1977, j’ai gagné 10 000 dollars, et je suis parti en vacances à Hawaï, en versant 800 dollars à une agence.
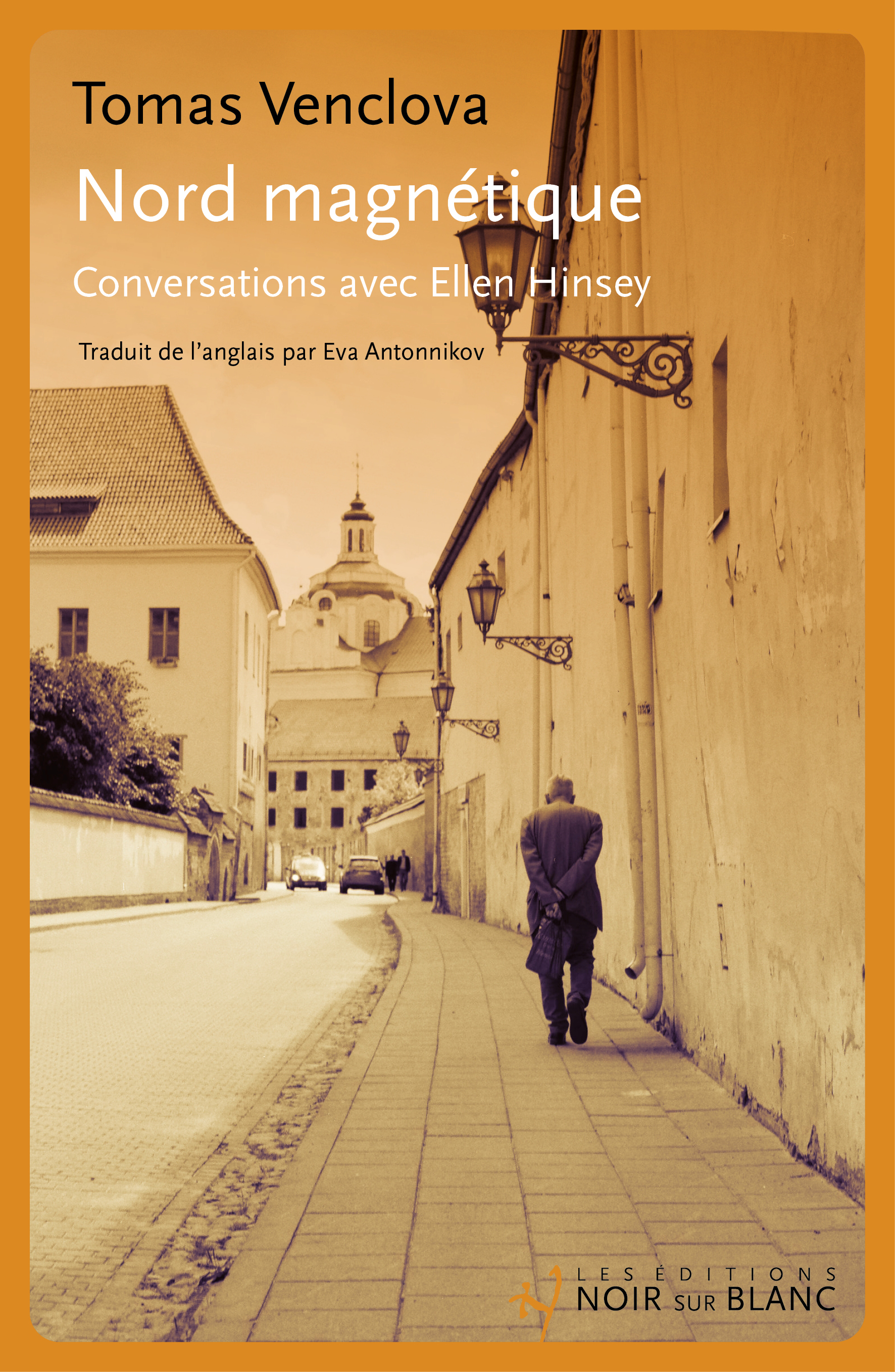
Pour un Soviétique, à cette époque…
Justement ! Et pendant que je me trouvais dans les îles, deux personnages sombres se sont présentés chez moi, à Berkeley, où habitait, en mon absence, un ami devenu aujourd’hui recteur de l’université de Kaunas. Ayant compris que j’étais absent, ils ont demandé à cet ami de me transmettre ceci : il fallait que je me présente au consulat soviétique à San Francisco ou que j’y envoie mon passeport par courrier pour y faire mettre un tampon. Je leur ai envoyé mon passeport en informant les autorités que j’avais un visa américain pour une durée de cinq ans, que j’avais l’intention de passer toutes ces années aux États-Unis, et je leur ai demandé de faire les corrections correspondantes dans mon passeport. Comme vous l’avez deviné, mon passeport ne me fut pas restitué, à la place j’ai reçu un papier disant que j’avais été déchu de la nationalité en juin (!), pour comportement indigne d’un citoyen soviétique. Cependant, en juillet, j’avais voyagé à Londres avec ce passeport ! En voilà un polar !
Qu’avez-vous fait ?
Je n’avais pas d’autre choix que de demander l’asile politique. À propos, je ne l’avais pas fait à Paris car, étant membre du Groupe Helsinki, j’entendais me ménager la possibilité de rentrer et de poursuivre le travail. Alors, j’ai fait la demande, qui a été acceptée, et, six ans plus tard, j’ai obtenu la nationalité américaine.
En URSS, on utilisait la déchéance de nationalité pour raisons politiques ; en France, on discute actuellement la possibilité d’appliquer cette mesure à ceux qui sont impliqués dans des activités terroristes. En Suisse, la perte de nationalité est impossible, à ce jour, en tout cas. Que pensez-vous d’une telle punition ?
Je crois que cela ne doit pas exister.
A peu près à la même époque que vous, Soljenitsyne, Rostropovitch et Vichnevskaïa furent déchus de la nationalité soviétique. Plus tard vint le tour de Iouri Lioubimov. Des dizaines d’années après, vous êtes tous rentrés dans votre patrie : eux, en Russie, vous, en Lituanie. Vous êtes donc tous reconnus comme des prophètes chez vous ?
M’autoproclamer prophète me met mal à l’aise, mais au fond, nous avions raison. Il est vrai que pendant onze ans, je pensais ne plus jamais revoir la Russie ou la Lituanie. Lorsque je venais à Berlin-Ouest, je regardais vers l’autre côté du Mur avec une sorte d’angoisse. En 1988, j’ai décidé de prendre le risque et je suis allé à Moscou et à Leningrad. Ma mère allait me rejoindre là-bas. J’avais des craintes et j’ai même écrit mon testament spirituel en deux exemplaires, que j’ai certifiés chez un notaire et donnés à deux amis aux États-Unis. J’y disais que si subitement, pendant mon séjour en URSS, j’apparaissais à la télévision soviétique en train de maudire l’Occident et de me repentir de mes erreurs, cela n’aurait que deux explications possibles. La première serait l’effet d’une maltraitance grave : si on me battait, je pourrais peut-être le supporter, mais si on m’enfonçait des aiguilles sous les ongles… Brodsky écrivait : « L’homme est un testeur de douleur, mais la limite de celle-là, et la sienne, il les ignore. » Ce sont mes vers préférés. La deuxième explication possible – ce ne serait pas moi, mais mon sosie, et il faudrait ne pas y prêter attention.
Si vous aviez tellement peur, pourquoi y êtes-vous allé ? Qu’est-ce qui l’a emporté sur la peur ?
J’avais envie de voir ma mère. Et puis, je suis très curieux de nature, et je voulais savoir ce qui se passait là-bas. J’avais également très envie de voir celle qui allait devenir ma femme et qui vivait à Leningrad. J’ai trouvé son adresse, et cela fait vingt-cinq ans que nous sommes ensemble.
Mais Brodsky n’est jamais retourné là-bas, bien qu’il rêve de Saint-Pétersbourg à Venise… Qu’en pensez-vous ?
Il y avait plusieurs raisons à cela. Primo, il était traumatisé car on lui avait refusé à deux reprises des visas et qu’on ne lui avait pas permis de se rendre aux enterrements de ses parents. Deuxio, il avait des problèmes personnels là-bas, et il ne voulait pas raviver sa plaie. Tertio, il en faisait une question de principe : s’il rentrait, ce serait pour toujours, et il pourrait alors vivre comme avant, dans les mêmes conditions, avec le même salaire. Cela seul serait honnête. Mais surtout, il était très malade et il avait peur qu’on ne puisse pas le sauver en Russie au cas où. Hélas, on ne l’a pas sauvé même en Occident.
En regardant en arrière, pensez-vous que le « malheur » d’être déchu de votre nationalité d’origine vous ait aidé à faire carrière, à devenir célèbre ? Sans cela, vous aurait-on invité à enseigner à Yale ?
Cela aurait été plus compliqué, mais en règle générale, j’ai eu beaucoup de chance dans la vie, comme si j’avais tiré un ticket gagnant. Je n’ai jamais été pauvre, je n’ai jamais fait de prison, j’ai épousé la femme que je voulais, bien qu’après un certain nombre de péripéties. J’avais envie de voyager, c’était l’une de mes motivations fortes pour partir en Occident – et j’ai vu pratiquement le monde entier, près d’une centaine de pays.
Au Forum des intellectuels russes à Vilnius, en 2015, on vous a qualifié de « russophile antisoviétique ». Pouvez-vous commenter ?
C’était la formule de mon ami Adam Michnik*, avec lequel nous avons bu pas mal de vodka, et même du tord-boyaux des camps. [*Figure de la société civile polonaise, dissident, journaliste, l’un des plus actifs opposants politiques des années 1968-1989. Rédacteur en chef de Gazeta Wyborcza, ndlr]. C’est sans doute une affirmation banale, mais la Russie est un grand pays, le pays d’une grande culture à l’histoire compliquée et malheureuse. J’aime la Russie et la langue russe, j’aime sa poésie, ma femme est russe… C’est pourquoi je suis russophile. Cependant, la politique russe – depuis Nicolas Ier (et même avant) jusqu’à Poutine – me rebute.
Parlons du rôle de l’intelligentsia. On a toujours pu y distinguer les créateurs loyalistes, qui se tiennent tout près du pouvoir, de ceux qui vivent selon la phrase de Griboïedov : « Amour de grands, ombre de buisson qui passe bientôt. » Comment voyez-vous l’intelligentsia russe aujourd’hui, qui est divisée entre les partisans du président Poutine et ceux que l’on traite de cinquième colonne ?
Il y a toujours eu aussi une troisième catégorie : ceux qui provoquaient la colère des grands, et ils étaient assez nombreux – de Tchaadaïev à Lénine, puis à Sakharov. Mais aujourd’hui, plusieurs de mes vieux amis russes sont subitement devenus des supporters de « la Crimée est à nous ». J’ai du mal à l’expliquer. L’instinct national est un sentiment puissant, je le remarque également en Lituanie. Ce sentiment est propre aux grands et aux petits peuples. Il est très difficile de combattre les émotions – or, il s’agit d’émotions – et ce combat n’a pas de sens, mais il faut essayer d’expliquer. Généralement, les gens ne comprennent pas qu’il y ait des valeurs plus grandes que le peuple. Pour un chrétien, c’est Dieu, pour un agnostique, c’est la conscience, la vérité. Je l’ai souvent répété : s’il faut choisir entre la vérité et la nation, je choisis la vérité. Bien entendu, il vaut mieux ne pas se trouver devant un tel choix, mais parfois c’est inévitable.
Diriez-vous que le rôle de l’intelligentsia est exagéré ? Ses représentants sont peu nombreux par rapport aux « autres » …
L’intelligentsia, en tout cas ses meilleurs représentants, c’est le sel de la terre, sans lequel le reste va se corrompre. On a beaucoup parlé de la différence entre les intelligentsias occidentale et russe. Au fond, ce mot n’existait pas en Occident, c’est un emprunt du russe. Ici, nous avons la notion d’intellectuel, mais il en est de différents. Il y a eu des admirateurs du fascisme et du communisme. Prenez Ezra Pound, par exemple.
Comment des notions peuvent-elles se substituer les unes aux autres ? Comment la belle notion de « patriote » devient-elle presque une injure ?
Hélas, il arrive souvent que des mots changent de nuance dans la bouche de locuteurs différents. Prenez le mot « cosmopolite », transformé en injure par d’aucuns. Or Érasme de Rotterdam se considérait comme cosmopolite, et c’est une figure entièrement positive. Jésus-Christ était certainement un cosmopolite.
En URSS, on ajoutait généralement au mot cosmopolite l’épithète « apatride » …
On l’ajoute toujours. Mais si on disait à la droite russe d’aujourd’hui qu’elle répète les paroles de Staline, elle pourrait se fâcher. Alors que c’est un fait avéré !
Vous souvenez-vous de ce vers de Boulat Okoudjava : « J’ai besoin d'une idole pour prier » ? Que pensez-vous du rôle de la religion dans la société contemporaine ?
La religion ne disparaîtra jamais, bien que, au premier abord, elle soit de moins en moins présente. Je ne parle pas de la Russie où la religion, en grande partie, est au niveau de Tartuffe. Quant à l’islam, cette religion vit encore son Moyen Âge et rappelle le christianisme à la même étape de son développement. C’est normal : l’islam a six cents ans de moins. En Occident, les églises se vident. Mais il me semble que le nombre de vrais chrétiens ne change pas beaucoup. Il y a eu et il y a toujours des Tartuffe qui font carrière sur la religion, il y a eu et il y a toujours le peuple qui conserve certains rituels qu’on enseignait en famille, et il existe de vrais chrétiens, qui sont toujours peu nombreux. En effet, l’homme a besoin d'une idole pour prier. Il faut surtout ne pas se tromper dans le choix de cette idole.
Vous avez longtemps enseigné à l’université Yale, l’une des meilleures au monde. Qui étaient vos étudiants ? Qu’est-ce que vous leur enseigniez ?
J’ai enseigné la poésie russe, surtout celle du XXe siècle Tsvetaïeva, Pasternak, Mandelstam, Blok… Le plus souvent, en russe. Lors du premier cours, j’avertissais les doctorants, qui étaient habituellement une dizaine, qu’ils seraient obligés de lire Ma sœur la vie en version originale. S’ils étaient capables de comprendre le texte de Pasternak, ils comprendraient mes cours. Certains étudiants connaissaient bien le russe, d’autres, moins bien, et quelques-uns étaient d’origine russe. L’écriture d’un essai en russe était encouragée, mais je ne baissais pas la note si on me soumettait un essai en anglais. Qu’est-ce que nous faisions ? Nous lisions des poèmes et nous les analysions dans le moindre détail, en essayant de comprendre pourquoi c’était de la bonne poésie. À en juger d’après leurs travaux, ils le comprenaient.
J’avais également un cours que je donnais en anglais : un panorama de la critique littéraire russe depuis Lomonossov jusqu’à Bakhtine et Lotman, mon maître. En guise de mémoire de fin d’année, j’ai proposé aux étudiants de choisir n’importe quel texte russe et d’écrire une critique littéraire dans le style d’un critique classique – Karamzine, Belinski, Chklovski… qui ils voulaient. Tout le monde a réussi, mais un Américain a écrit un texte génial : il a pris Le Timbre égyptien de Mandelstam et a écrit à son sujet une pseudo lettre de Viazemski à Pouchkine. Viazemski y parle de l’apparition d’un poète romantique, si romantique qu’il est difficile de le lire, mais on peut comprendre quand même, et il affirme que ce poète, à l’évidence, est plutôt doué. Il se permet même de mentionner que Pouchkine mourrait dans un duel, ce qui serait dommage. Et tout est comme ça. Il y a des Américains extraordinaires, mais il s’agit de Yale où le niveau est très élevé. Généralement, les étudiants choisissent des matières qu’ils ne connaissent pas et, à la fin d’année, ils en savent plus que leurs professeurs.
J’ai beaucoup aimé votre définition de l’optimisme apocalyptique : « Tout se terminera bien, mais personne ne sera plus en vie pour le voir. » Vous avez pourtant vu des changements très positifs, n’est-ce pas ?
Sans aucun doute ! J’avais un ami lituanien qui disait : « Toute ma vie, j’ai prié Dieu de prolonger ma vie pour que je voie la Lituanie et l’Europe de l’Est libres. Dieu, dans sa sagesse infinie, a fait encore mieux : il n’a pas prolongé ma vie, mais a accéléré le cours de l’histoire. » Je trouve cela génial ! Actuellement, l’histoire accélère de nouveau sa course, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans la bonne direction. Il est de nouveau dangereux de vivre dans ce monde.
Il n’existe pas de culture en dehors de la politique, c’est pour cela qu’on l’appelle aussi « soft power ». Mais peut-elle réellement influencer d’autres sphères ?
Au XIXe siècle, il y avait en Pologne un rebelle du nom de Romuald Traugutt. En fin de compte, il fut pendu. Sa femme, qui l’accompagnait au moment de son départ pour la rébellion, lui a demandé : « Est-ce que cela a un sens ? » Il a répondu : « Cela n’a pas de sens, mais c’est nécessaire. » Pour la culture, c’est pareil.
Nous nous sommes rencontrés en Suisse. Que pensez-vous de ce pays ?
La Suisse justifie sa réputation de pays où chaque paysage est comme une carte postale. Je n’aurais pas pu y vivre je n’ai pas assez de moyens, en tout cas, pas pour une vie qui me donne satisfaction. Mais la Suisse m’intéresse en tant que pays d’émigrés – que de gens célèbres ont vécu ici ! On peut y faire un pèlerinage sur de nombreuses tombes. C’est ce que ma femme et moi avons fait. Nous avons eu une petite mésaventure avec la tombe de Nabokov : l’employé du cimetière nous a dit qu’il était facile de le trouver car il reposait près de Kandinsky.Seulement, il a confondu ce peintre et Kokoschka ! À Zurich, on nous a dirigés vers Thomas Mann en indiquant la tombe de Gottfried Keller comme point de repère. Plus généralement, j’ai mis à profit mon mois de résidence au château Lavigny pour travailler à un chapitre consacré à la Lituanie indépendante des années 1920-1930. Ce chapitre fera partie de mon livre sur l’histoire de la Lituanie destiné au grand public.
Vous êtes un homme particulier. Lorsque vous êtes allé à Athènes, vous avez fréquenté un quartier bien douteux, où le roi Œdipe serait mort. Lorsque vous êtes parti en croisière de la Sardaigne à Livourne, vous avez eu le courage de vous lever à 3 heures du matin pour voir l’île de Montecristo. L’âge n’est donc pas un obstacle pour les poètes ? Être poète, est-ce un état d’âme ?
C’est probablement une conformation particulière de l’âme. Cela existe chez tout le monde, mais chez certains, c’est plus prononcé, et ce sont eux qui commencent à écrire. Pour ne plus pouvoir s’arrêter.



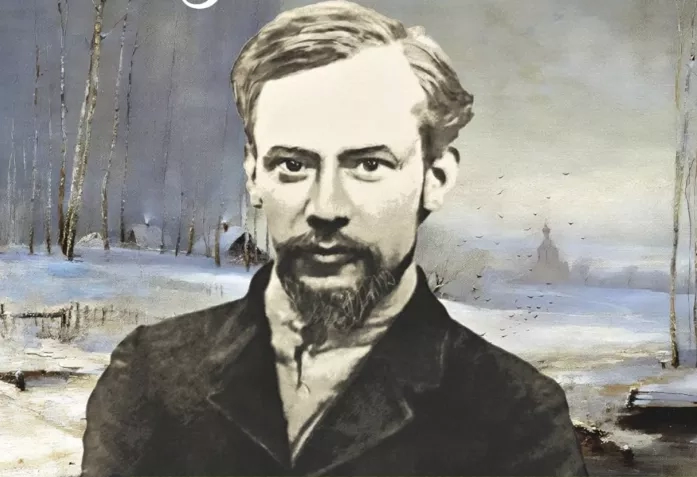
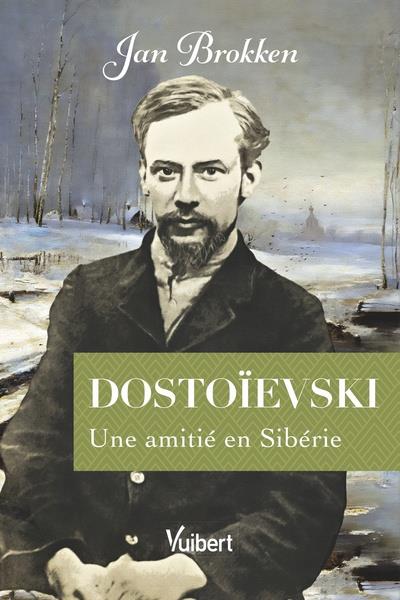

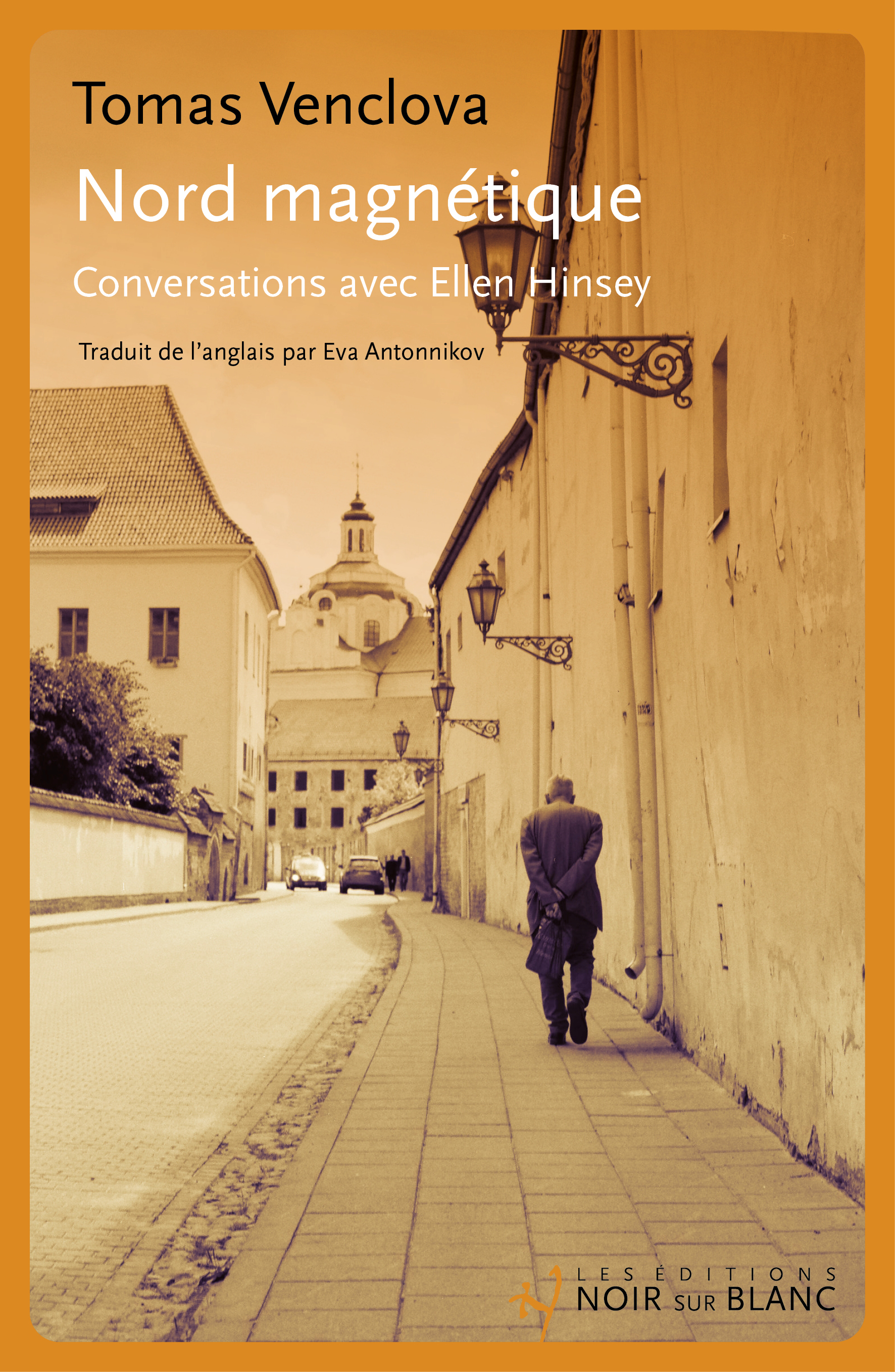


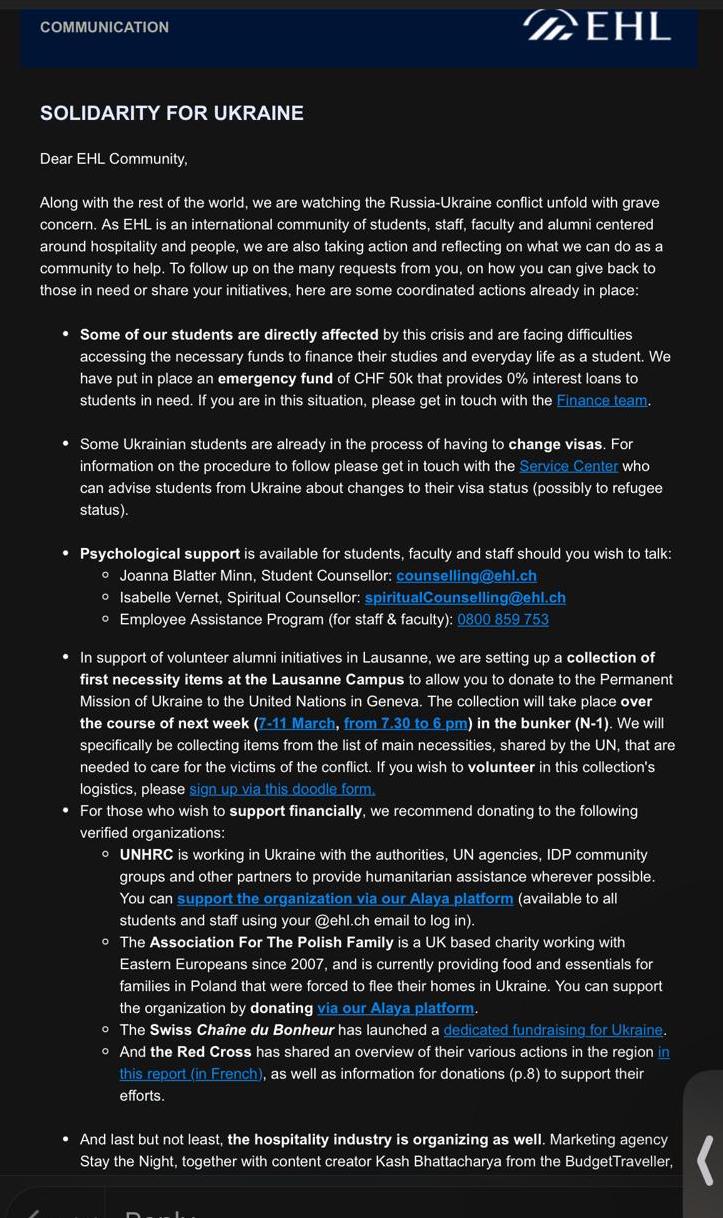

















COMMENTAIRES RÉCENTS