À partir du 11 mars et durant les prochaines semaines le magazine « T », que vous recevez le samedi avec votre exemplaire du Temps, va publier un débat épistolaire entre l’écrivain français Iegor Gran et moi-même. Le final se jouera sur la scène du Grand Théâtre de Genève, le 11 mai 2023. Formellement, ce projet a débuté il y a six mois, mais il m’aura transportée dans un passé bien plus lointain.
… Nous sommes en septembre 1987, l’année scolaire vient de commencer dans un pays enivré par la perestroïka. Étudiante de troisième année à l’École de journalisme de l’Université de Moscou, j’attends, sur un banc de l’aula Kommounistitcheskaïa (« Communiste ») de son bâtiment historique sis en face du Kremlin, le premier cours de la professeure Galina Andreïevna Belaïa. (En 1949, cette spécialiste de la littérature soviétique mondialement connue n’avait pas osé déposer sa candidature d’étudiante à cette même université en raison des origines juives de sa mère dont presque toute la famille avait été exterminée en 1920 lors d’un pogrom près de Poltava.) La professeure est arrivée : de taille moyenne, un peu corpulente, modestement élégante. Montée en chaire, elle nous salue et, des étincelles brillant dans ses yeux noirs, ordonne : « Sortez vos listes de lecture obligatoire ». Nous nous exécutons. « Biffez… » Je passe sur les noms des auteurs ainsi éliminés et continue avec ceux annoncés à la suite de l’injonction suivante : « Ajoutez ». Zamiatine, Pasternak, Mandelstam, Boulgakov, Akhmatova… Tous ceux que Galina Andreïevna appelait « les Don Quichotte des années 1920 ». À l’époque, leurs livres, jusqu’alors uniquement accessibles dans les succursales de la chaîne « Beriozka » réservées aux étrangers et aux diplomates, commençaient à paraître en grands tirages. Un monde qui nous avait été caché nous a ainsi été rendu ; le monde de notre propre littérature – magnifique, variée, humaniste, nourrie par la souffrance.
Décrire Galina Belaïa, c’est décrire l’histoire de l’intelligentsia métropolitaine russe de la deuxième moitié du XXe siècle dont elle était une représentante à la fois typique et exceptionnelle. Selon ses propres mots, elle ne prétendait pas être une héroïne, mais essayait toujours d’agir avec décence. Comme beaucoup de mes professeurs, elle nous donnait une leçon de vie par son propre exemple. Lors de son premier cours elle choisit de parler du rôle singulier que joue la littérature dans une société fermée, puis d’Andreï Siniavski, qu’elle reverra l’année suivante, au Danemark, après un interlude de presque vingt ans.
Nous ne savions rien d’Andreï Siniavski, né dans une famille de la petite noblesse ralliée aux socialistes-révolutionnaires de gauche et rentré dans l’histoire de la littérature et de la dissidence sous le pseudonyme d'Abram Tertz. On dit que c’était à lui que Svetlana Allilouïeva, la fille de Staline, avait adressé en 1963 ses Vingt lettres à un ami. On sait qu’il figurait parmi ceux à qui le critique américain Andrew Field avait dédié, en 1967, sa biographie de Vladimir Nabokov, presque tout aussi inconnu de nous à l’époque.
Yeux grands ouverts, bouches bées, nous écoutions l’histoire de cet homme courageux, critique littéraire brillant et auteur doté d’un talent rare qui avait osé publier en Occident ses œuvres satiriques qui n’auraient jamais passé à travers la grille de la censure soviétique. Le KGB mit plusieurs années à découvrir sa véritable identité : l’idée qu’un Russe « normal » pourrait se cacher derrière un nom juif ne leur avait pas traversé l’esprit. Mais en automne 1965, Siniavski fut arrêté et dut subir, en 1966, un procès en même temps que son ami Iouli Daniel, lui aussi coupable d'avoir publié en Occident. Daniel fut condamné à cinq ans, Siniavski à sept ans de camp à régime sévère selon l’article 70 du Code pénal russe – « propagande antisoviétique ». Aucun des deux écrivains ne reconnut sa culpabilité. Ce procès marqua la fin du « Dégel » initié par Nikita Khrouchtchev et la naissance de la dissidence en Union soviétique. Ayant travaillé dans le camp en tant qu’arrimeur, Siniavski fut libéré en 1971 et gracié par Iouri Andropov. Le 17 octobre 1991, le journal soviétique Izvestia déclarait le procès de 1966 comme non-lieu. À ce moment, cela faisait trois ans que Iouli Daniel était mort et presque vingt ans que Andreï Siniavski enseignait la littérature russe à la Sorbonne, à Paris, où il était arrivé après sa libération avec sa femme, Maria Rosanova, et son fils Iegor, âgé de neuf ans lors du déménagement.
Quelle probabilité existait-il pour qu’un jour je rencontre ce garçon entre-temps devenu écrivain français ? Zéro. Et pourtant. Le 4 septembre 2022, par un beau dimanche ensoleillé, tout juste trente-cinq ans après le fameux cours magistral de la professeure Belaïa à Moscou, j’arrive à Morges à l’occasion du « Livre sur les quais ». Cette fois-ci, non pas pour travailler car aucun auteur russe n’était au programme. Juste pour le plaisir. À peine arrivée, je rencontre une amie chère, une éditrice (je sais qu’elle préférerait ne pas être nommée) qui me demande si je sais qui est Andreï Siniavski. Affirmatif. « Viens que je te présente à son fils. » Elle m’emmène au stand où Iegor Gran (qui a pris le nom de famille de son épouse) dédicace ses livres. Mon amie me présente, lui parle, en français bien sûr, de Nasha Gazeta etc. Je l’interromps doucement et utilise, en russe, ce mot de passe : « Vous savez, Iegor, je suis une ancienne élève de Galina Belaïa ».
… Ayant lu le livre de Iegor Gran Les services compétents (2020) dans lequel il raconte, mieux que personne, l’histoire de sa famille, ainsi que Z comme zombie (2022) – une explication de la signification que cette lettre innocente de l’alphabet latin a pris en Russie dès le début de la guerre en Ukraine –, je voulais lui proposer une interview. Mais alors que je m’apprêtais à le contacter, je reçus une proposition de Rinny Gremaud, rédactrice-en-cheffe du magazine « T », de participer à leur nouveau projet : un duel épistolaire sur le thème « Comment peut-on encore aimer la Russie aujourd’hui ? » Avec Iegor Gran dans le rôle de mon adversaire. C’était en octobre. J’avoue qu’ayant appris que nos textes ne seraient publiés qu’à partir de mars 2023, je doutais de la pertinence de cette aventure : je croyais alors que la guerre serait terminée d’ici là et que nos réflexions seraient devenues obsolètes. Hélas, je me suis trompée. Et suis heureuse que tous deux, unis dans la dénonciation sans équivoque de la guerre, ayons accepté de jouer le jeu consistant à présenter au public nos positions nuancées.
Ce projet s’est avéré pour moi à la fois passionnant et épuisant, car il a exigé une analyse profonde de diverses couches de mon identité, une mise en question de plusieurs certitudes et la perte de maintes illusions. Il a réveillé bien des souvenirs agréables ainsi que d’autres douloureux, et m’a forcé à percevoir des couleurs dans un monde que certains nous présentent comme noir et blanc. Et ceci tout en essayant de garder un certain degré d’élégance qui distingue un duel d’une bastonnade. Je vous laisse juges du résultat…
PS Les places sont à réserver ici.







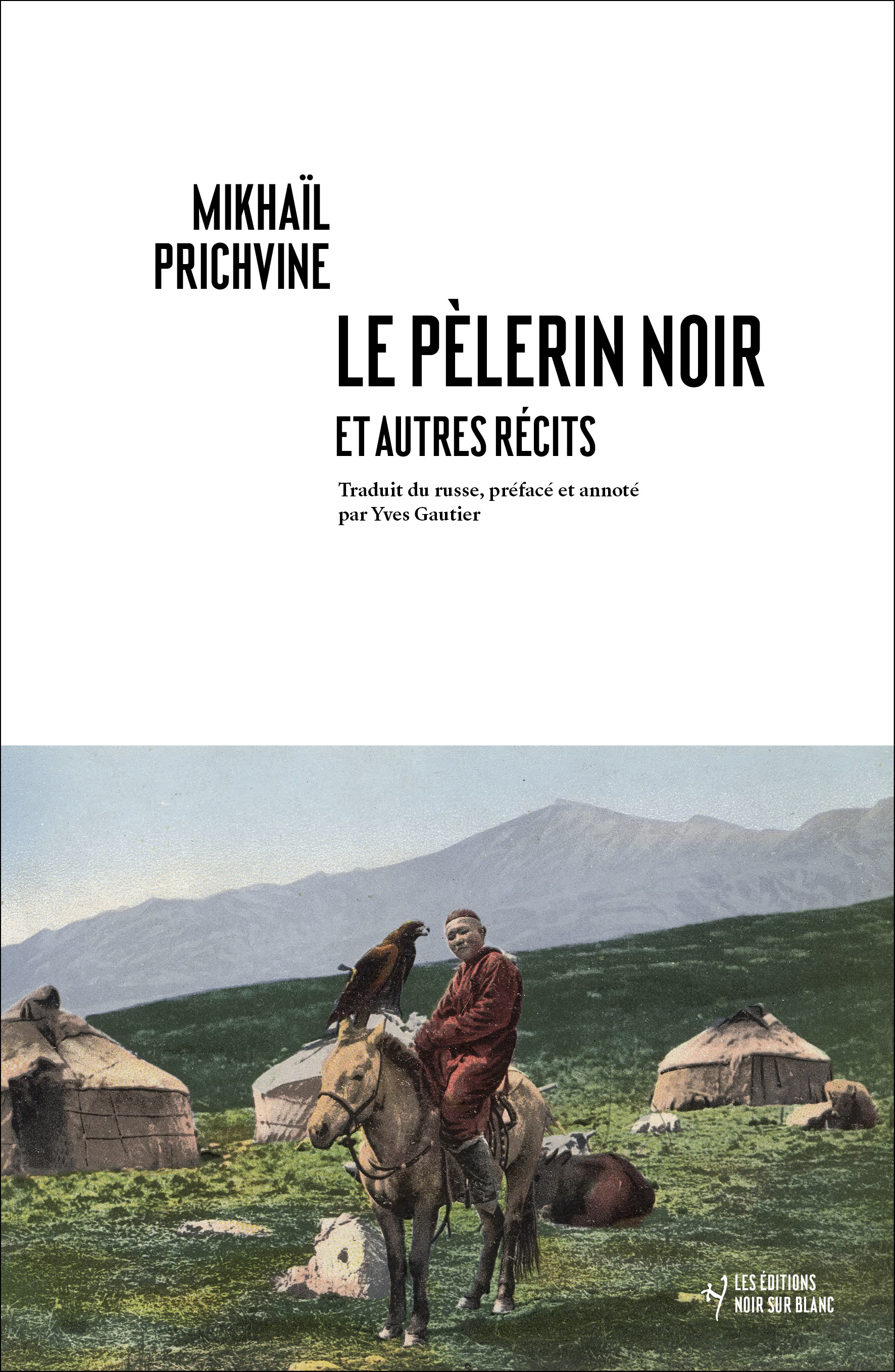















COMMENTAIRES RÉCENTS